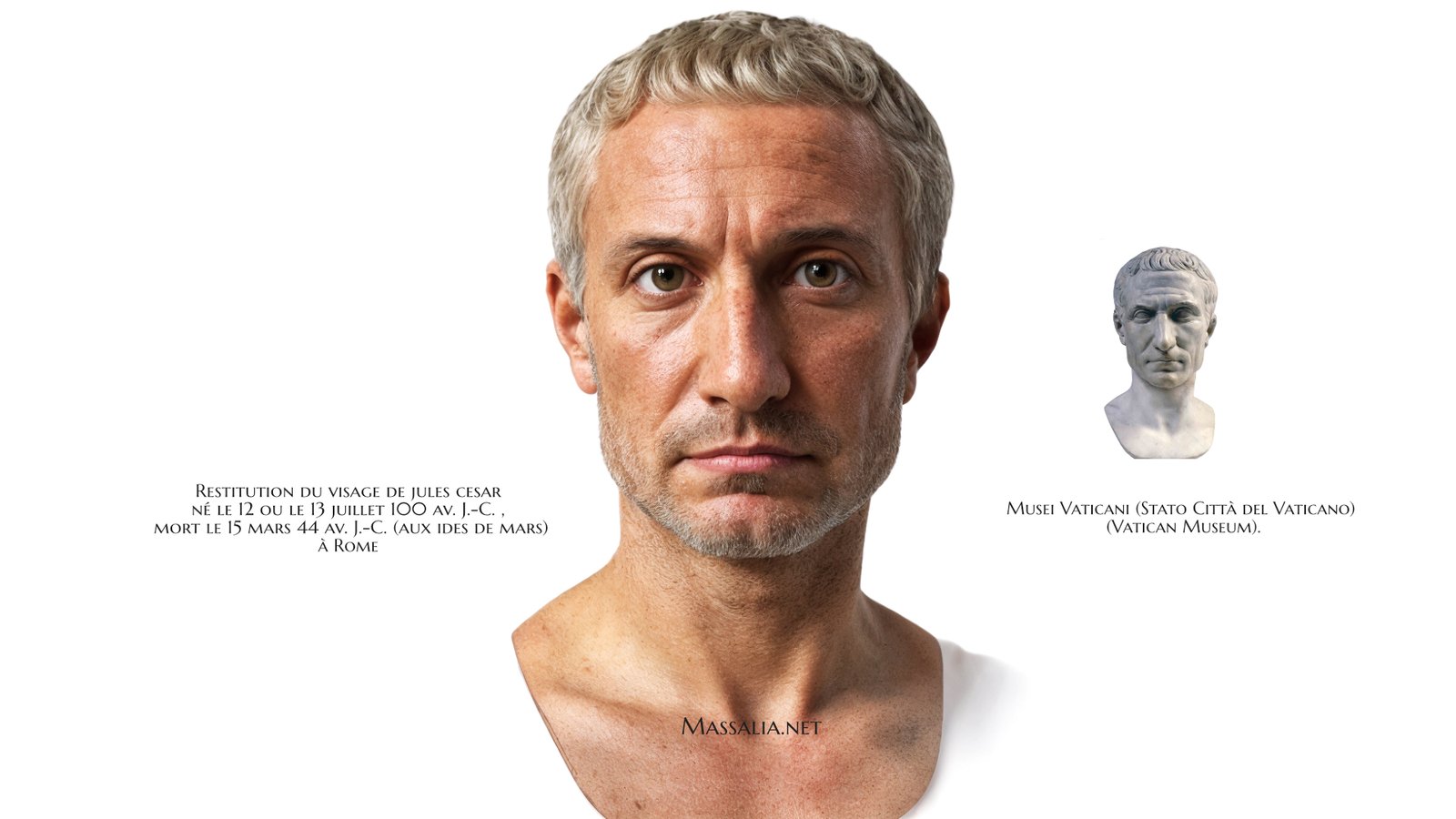La guerre civile entre César et Pompée éclate en 49 av. J.-C
La mort de Crassus en 53 av. J.-C. et celle de Julia (fille de César et épouse de Pompée) en 54 av. J.-C. ont fragilisé l’alliance entre les deux hommes. Pompée s’est alors rapproché des optimates (faction conservatrice du Sénat) en épousant Cornelia, fille de Metellus Scipion.
La guerre civile entre César et Pompée éclate en 49 av. J.-C., marquant l’un des derniers conflits majeurs de la République romaine. Cette confrontation est l’aboutissement d’une longue détérioration des relations entre les deux hommes, autrefois alliés au sein du premier triumvirat avec Crassus. Plusieurs événements ont précipité le conflit :
La situation s’est envenimée lorsque le Sénat, soutenant Pompée, a ordonné à César de rentrer à Rome et de dissoudre son armée à la fin de son mandat de proconsul en Gaule. César propose alors un compromis : il accepterait de dissoudre son armée si Pompée en faisait autant. Cette proposition est rejetée par le Sénat.
Le point de non-retour est atteint en janvier 49 av. J.-C. :
- Le 1er janvier : le Sénat rejette l’ultimatum de César
- Le 7 janvier : César est déclaré ennemi public
- Le 10 janvier : César franchit le Rubicon avec la XIIIe légion, acte qui marque officiellement le début de la guerre civile
Face à cette situation, Pompée et la majorité du Sénat fuient Rome pour la Grèce en février 49 av. J.-C., laissant l’Italie pratiquement sans défense.
Le siège de Marseille par l’armée de César [3D]
Les Nocturnes du Plan de Rome – 06 mai 2015″ de la chaîne CIREVE présente une étude de cas sur le siège de Marseille par César en 49 avant J.-C.
Le siège de Marseille raconté par césar
Les « Commentaires sur la guerre civile » (Commentarii de Bello civili) de Jules César constituent une œuvre en trois livres couvrant les événements du 1er janvier 49 av. J.-C. à la fin novembre 48 av. J.-C. L’œuvre, probablement rédigée vers 46 av. J.-C., constitue à la fois une apologie et un pamphlet justifiant la politique de César. Contrairement aux Commentaires sur la guerre des Gaules, cet ouvrage appartient davantage au genre apologétique qu’aux mémoires purs. César adopte un ton mesuré : il utilise systématiquement le terme adversarius (adversaires) plutôt que hostes (ennemis) pour désigner les pompéiens, soulignant qu’ils restent tous citoyens romains3. L’ouvrage présente également une « truculente galerie de portraits » où figurent un Pompée vaniteux, un Caton aigri et un Scipion cupide. L’œuvre s’interrompt brutalement en pleine bataille d’Alexandrie, laissant inachevé ce témoignage direct du protagoniste principal de cette guerre civile décisive.
César devant Marseille (1,34-35)
-1,34 – (1) À son arrivée, César apprit que Pompée avait envoyé en Espagne Vibullius Rufus, que peu de jours auparavant on avait pris à Corfinium et relâché par son ordre; (2) qu’en outre, Domitius était parti pour aller se jeter dans Marseille avec sept galères qu’il avait enlevées par force à des particuliers dans l’île d’Igilium et dans le Cosanum, et qu’il avait remplies de ses esclaves, de ses affranchis, et de colons de ses terres; (3) et en outre, que Pompée, à son départ de Rome, avait expédié devant lui, comme députés, dans leur patrie, de jeunes Marseillais de nobles familles, en les exhortant à ne pas oublier ses anciens bienfaits pour les obligations plus récentes qu’ils pouvaient avoir à César. (4) Conformément à ces instructions, les Marseillais avaient fermé leurs portes à César, en appelant à leur secours les Albiques, peuple sauvage qui, de tout temps, leur était dévoué et qui habitait les montagnes au-dessus de Marseille; (5) ils avaient fait entrer dans leur ville tout le blé des contrées et des châteaux du voisinage, avaient établi des fabriques d’armes, et réparaient leurs murailles, leurs portes, leurs navires.
– 1,35 – (1) César mande quinze des principaux Marseillais; il les engage à n’être pas les premiers à commencer la guerre, leur remontrant qu’ils doivent plutôt suivre le sentiment de toute l’Italie que de déférer à la volonté d’un seul. (2) Il ajoute à cela tout ce qu’il croit capable de les guérir de leur témérité. (3) Les députés reportent ces paroles à leurs concitoyens, et, par leur ordre, reviennent dire à César: « Que voyant le peuple romain divisé en deux partis, ils ne sont ni assez éclairés, ni assez puissants pour décider laquelle des deux causes est la plus juste; (4) que les chefs de ces partis, Cn. Pompée et C. César, sont l’un et l’autre les patrons de leur ville; que l’un leur a publiquement accordé les terres des Volques Arécomiques et des Helviens; et que l’autre, après avoir soumis les Gaules, a aussi augmenté leur territoire et leurs revenus. (5) En conséquence ils doivent pour des services égaux témoigner une reconnaissance égale, ne servir aucun des deux contre l’autre, ne recevoir ni l’un ni l’autre dans leur ville et dans leurs ports.
Début du siège de Marseille (1,36)
– 1,36- (1) Pendant que ces choses se passent, Domitius arrive à Marseille avec ses vaisseaux, et, reçu par les habitants, prend le commandement de la ville. On lui donne aussi la conduite de la guerre. (2) Par son ordre ils expédient leur flotte dans toutes les directions, vont chercher de côté et d’autre les vaisseaux de charge, et les amènent dans le port: ceux qui sont en mauvais état leur fournissent des clous, du bois, des agrès, pour radouber et armer les autres; (3) ils mettent dans les greniers publics tout le blé qu’ils peuvent recueillir, et serrent les autres approvisionnements et tout ce qui peut leur être d’usage en cas de siège. (4) Irrité de cette injure, César vient avec trois légions à Marseille, élève, pour l’attaque de la ville, des tours et des mantelets, fait équiper, à Arles, douze galères. (5) Achevées et armées dans l’espace de trente jours, y compris celui où l’on avait coupé le bois, elles sont amenées à Marseille; César en donne le commandement à Decimus Brutus, et laisse C Trébonius, son lieutenant, pour conduire le siège.
marine romaine tactiques de la flotte républicaine
Continuation du siège de Marseille (1,56-58)
-1,56 – Tandis que ces choses se passent du côté d’Ilerda, les Marseillais équipent, par le conseil de L. Domitius, dix-sept galères, dont onze pontées. (2) Ils y ajoutent beaucoup de barques légères, afin d’effrayer notre flotte par la quantité, y mettent une multitude d’archers et de ces Albiques dont on a parlé plus haut, et n’épargnent, pour les exciter, ni récompenses, ni promesses. (3) Domitius demande pour lui-même quelques navires, et les remplit des cultivateurs et des pâtres qu’il a amenés. (4) Alors, leur flotte étant prête, ils s’avancent avec assurance contre nos vaisseaux, commandés par D. Brutus, et qui étaient à l’ancre près d’une île située vis-à-vis Marseille.
– 1,57 – La flotte de Brutus était de beaucoup inférieure en nombre; mais César l’avait composée de l’élite de toutes ses légions, de soldats choisis dans les premiers rangs, et de centurions qui avaient eux-mêmes demandé cet emploi. (2) Tous s’étaient pourvus de mains de fer, de harpons, d’une grande quantité de javelots, de dards et d’autres traits. En conséquence à l’approche de l’ennemi, ils sortent du port et attaquent ceux de Marseille. (3) On combattit vivement et avec vigueur de part et d’autre. Les Albiques, montagnards robustes et aguerris, ne le cédaient guère aux nôtres en courage, (4) et, à peine sortis de la ville, ils avaient encore l’esprit plein des promesses qu’on leur avait faites. Quant aux pâtres de Domitius, ces hommes féroces, animés par l’espoir de la liberté, et par la présence de leur maître, s’efforçaient de lui montrer ce qu’ils savaient faire.
– 1,58 – Les Marseillais, forts de la vitesse de leurs navires et de l’adresse de leurs pilotes, évitaient ou soutenaient aisément le choc des nôtres, et, étendant leurs ailes autant que l’espace le permettait, ils tâchaient de nous envelopper, réunissaient plusieurs de leur vaisseaux contre un des nôtres, et s’appliquaient à briser nos rames en passant. (2) S’ils étaient forcés d’en venir à l’abordage, l’expérience et l’habileté de leurs pilotes faisaient place à la valeur des montagnards. Pour les nôtres, ils n’avaient que des rameurs et des pilotes mal exercés, tirés tout à coup des vaisseaux de transport, et ignorant même les termes de la manoeuvre; d’autre part la pesanteur de leurs vaisseaux en gênait les mouvements, et, faits à la hâte et de bois vert, ils ne pouvaient avoir la même vitesse. (4) Mais aussi, dès que l’on venait à s’approcher, ils ne s’inquiétaient nullement d’avoir affaire à deux vaisseaux à la fois; et lançant la main de fer, ils les retenaient tous les deux, combattaient à droite et à gauche, et montaient à l’abordage. Après un grand carnage des Albiques et des pâtres, ils coulèrent à fond une partie de leurs vaisseaux, en prirent plusieurs, avec l’équipage, et chassèrent les autres dans le port. Ce jour-là les Marseillais perdirent neuf galères, en comptant celles qui furent prises.
Suite des opérations devant Marseille (2,1)
– 2,1 – (1)Tandis que ces événements se passent en Espagne, Caius Trébonius, lieutenant de César, que celui-ci avait laissé au siège de Marseille, dresse contre la ville les mantelets et les tours, et forme deux attaques, (2) l’une dans le voisinage du port et de l’arsenal des vaisseaux, l’autre du côté qui mène de la Gaule et de l’Espagne à cette partie de la mer qui touche à l’embouchure du Rhône. (3) En effet, Marseille est baignée par la mer presque de trois côtés; il n’y a qu’un seul côté où l’on ait accès par terre: encore la partie qui touche à la citadelle est-elle très forte et par sa position et par une vallée profonde qui en rendent l’attaque longue et difficile. (4) Pour exécuter ces travaux, Caius Trébonius fait venir de toute la province un grand nombre d’hommes et de chevaux, et se fait apporter des matériaux et des fascines avec lesquels il élève une terrasse de quatre-vingts pieds de haut
Travaux d’approche (2,2)
– 2,2 – (1) Mais on avait depuis longtemps pourvu la ville d’une telle quantité de munitions de guerre et de machines, qu’il n’y avait point de mantelets d’osier qui pussent résister à leurs efforts. (2) Des perches de douze pieds de long, armées de fer par le bout, étaient lancées par d’énormes balistes, et, après avoir traversé quatre rangs de claies, allaient encore se ficher en terre. (3) En conséquence, on fit une galerie couverte avec des poutres épaisses d’un pied et jointes ensemble; et sous cet abri on se passait de main en main ce qui était nécessaire pour la construction de la terrasse. (4) Afin de mettre le terrain au niveau, on avait placé en avant une tortue de soixante pieds, également composée de fortes poutres et enveloppée de tout ce qui pouvait la garantir du feu et des pierres. (5) Mais l’étendue des ouvrages, la hauteur du mur et des tours, le grand nombre de machines des assiégés, retardaient tous les travaux. (6) En outre, les Albiques faisaient de fréquentes sorties et venaient lancer des feux sur les tours et la terrasse; mais nos soldats les repoussaient aisément, et, après leur avoir fait perdre beaucoup de monde, les rejetaient dans la ville.
Renfort de Nasidius (2,3)
– 2,3 – (1) Cependant Lucius Nasidius, que Cnaeus Pompée envoyait au secours de Lucius Domitius et des Marseillais avec seize navires, dont quelques-uns avaient la proue d’airain, pénètre dans le détroit de Sicile à l’insu de Curion qui avait manqué de prévoyance. (2) Il aborde à Messine, où la terreur est telle que le sénat et les principaux citoyens prennent la fuite, enlève une galère dans le port, (3) la joint au reste de sa flotte et continue sa route vers Marseille. Il avait envoyé devant lui secrètement une petite barque annoncer sa venue à Domitius et aux Marseillais, et les exhorter vivement à tenter, avec le secours qu’il leur amenait, un second combat naval contre Brutus.
Seconde bataille navale (2,4-7)
-2,4 – (1) Les Marseillais, depuis leur premier échec, avaient remplacé les vaisseaux perdus par un même nombre de vieilles galères, tirées de leur arsenal, radoubées et armées avec beaucoup de soin; ni les rameurs ni les pilotes ne leur manquaient. (2) Ils y avaient ajouté des barques de pêcheurs, qu’ils avaient couvertes pour que les rameurs fussent à l’abri du trait, et remplies d’archers et de machines. (3) Leur flotte ainsi équipée, encouragés par les prières et les larmes des vieillards, des mères de famille, des jeunes filles, qui les conjurent de sauver leur patrie dans cette extrémité, ils montent sur les vaisseaux avec la même résolution et la même assurance qu’ils avaient montrées dans le combat précédent. (4) Car telle est la faiblesse humaine, que les choses que nous n’avons jamais vues, qui nous sont nouvelles, inconnues, nous inspirent ou plus de confiance ou plus d’effroi; c’est ce qui eut lieu alors. L’arrivée de Lucius Nasidius avait rempli les esprits d’espérance et de bonne volonté. (5) Secondés par un vent favorable, ils sortent du port et joignent Nasidius à Tauroentum, château qui appartient aux Marseillais. Là ils disposent leurs vaisseaux, se concertent ensemble, et se confirment dans la résolution de combattre. L’aile droite est donnée aux Marseillais, la gauche à Nasidius.
-2,5 – (1) Brutus va à leur rencontre avec sa flotte augmentée de plusieurs vaisseaux; car aux galères construites à Arles d’après l’ordre de César, il en avait ajouté six prises sur les Marseillais. Il avait employé les jours précédents à les remettre en état et à les équiper. (2) Ayant donc exhorté les siens à mépriser, après sa défaite, un ennemi qu’ils avaient vaincu lorsqu’il avait toutes ses forces, il marche contre eux plein d’espoir et de résolution. (3) Il était facile, du camp de Trébonius et de toutes les hauteurs, de voir, dans la ville, toute la jeunesse qui était restée, les vieillards, les femmes, les enfants, les gardes de la cité, lever leurs mains au ciel du haut des murailles, ou courir aux temples des dieux, et, prosternés devant leurs images, leur demander la victoire: (4) car personne, parmi eux ne doutait que ce jour-là ne dût décider de leur sort. (5) Les jeunes gens les plus distingués et les personnages les plus considérables, sans distinction d’âge, avaient été sommés et conjurés chacun nommément de monter sur les vaisseaux. Ainsi, en cas de revers, ils se trouvaient sans ressources; vainqueurs, ils comptaient sauver la ville tant par leurs propres forces que par les secours qui leur viendraient du dehors.
-2,6 – (1) Le combat engagé, les Marseillais déployèrent la plus grande valeur. Le souvenir des exhortations qu’ils venaient d’entendre les animaient tellement au combat qu’à les voir on les eût crus persuadés qu’ils n’avaient plus que ce moment pour leur défense, et que ceux qui périraient dans l’action ne précéderaient que de peu d’instants le reste de leurs concitoyens qui devaient subir le même sort, si la ville était prise. (2) Nos vaisseaux s’étant peu à peu séparés, l’ennemi put mettre à profit l’habileté de ses pilotes et l’agilité de ses navires; si parfois nous trouvions le moyen d’en saisir un avec les mains de fer, tous les autres accouraient à son secours. (3) Réunis aux Albiques, ils se battaient de près volontiers et ne le cédaient pas de beaucoup aux nôtres en valeur; en même temps, de leurs moindres vaisseaux ils nous lançaient sans cesse une grêle de traits par lesquels nos soldats inattentifs ou occupés ailleurs, étaient surpris et blessés. (4) Deux de leurs trirèmes, apercevant celle que montait Decimus Brutus, qu’il était aisé de reconnaître à son pavillon, s’élancèrent de deux côtés sur elle; mais les ayant remarquées, Brutus fit marcher son vaisseau avec tant de rapidité qu’en un clin d’œil il eut pris les devants. (5) Ces deux galères se heurtèrent si violemment qu’elles en furent très endommagées; l’une d’elles brisa son éperon et fut toute fracassée. Alors quelques vaisseaux de la flotte de Brutus, qui n’étaient pas loin de là, s’apercevant de leur désastre, courent sur elles et les ont bientôt coulées à fond.
-2,7] – (1) Quant aux vaisseaux de Nasidius, ils ne furent d’aucun secours et ne tardèrent pas à se retirer du combat. Ni la vue de la patrie, ni les instances de leurs proches n’animaient ces hommes à braver le péril et la mort; (2) aussi aucun de leurs vaisseaux ne périt. Pour les Marseillais, ils eurent cinq galères coulées à fond; quatre furent prises; une s’enfuit avec les vaisseaux de Nasidius et gagna avec eux l’Espagne citérieure. (3) Une de celles qui restaient aux vaincus fut dépêchée à Marseille pour y porter la nouvelle du désastre. Comme elle approchait de la ville, les habitants se précipitèrent en foule à sa rencontre pour savoir ce qui s’était passé: quand ils surent l’événement, ils furent saisis d’une telle douleur qu’on eût dit que la ville était déjà prise. Toutefois les Marseillais n’en mirent pas moins d’ardeur à tout préparer pour la défense.
Construction d’une tour (2,8-9)
-2,8 – (1) Les légionnaires, qui travaillaient aux ouvrages de la droite, remarquèrent qu’une tour de briques élevée au pied de la muraille pourrait leur être d’un grand secours contre les fréquentes sorties des ennemis. Celle que l’on avait faite d’abord était trop basse et trop petite; (2) cependant elle leur servait de retraite; c’était de là qu’ils se défendaient quand l’ennemi les pressait vivement; c’était de là qu’ils sortaient pour le repousser et le poursuivre. Cette tour avait trente pieds en tous sens, et les murs avaient cinq pieds d’épaisseur. (3) Par la suite, comme l’expérience est un grand maître en toutes choses, à force de combinaisons habiles on reconnut que si on l’élevait plus haut, on pourrait en tirer encore plus de service. Voici de quelle manière on s’y prit.
-2,9 – (1) Lorsque la tour eut été élevée à la hauteur d’un étage, ils bâtirent le mur de telle sorte que la maçonnerie recouvrît l’extrémité des poutres, et qu’il n’y eût aucune partie saillante où l’ennemi pût mettre le feu. (2) Par-dessus ce plancher ils continuèrent le mur de briques, autant que le permirent les parapets et les mantelets sous lesquels ils étaient à couvert; ils posèrent ensuite, assez près de l’extrémité de la muraille, deux solives en croix pour y suspendre la charpente qui devait servir de toit à leur tour; et sur ces solives ils mirent des poutres de traverse qu’ils lièrent ensemble par des chevilles. (3) Ils choisirent ces poutres un peu longues et dépassant un peu le mur, afin qu’on pût y attacher de quoi mettre à couvert les ouvriers occupés à la construction de la muraille; (4) ils couvrirent ce plancher de briques et de mortier pour qu’il fût à l’épreuve du feu, et jetèrent par-dessus de grosses couvertures, de peur que le plancher ne fût brisé par les traits des machines, ou que les briques ne fussent détachées par les pierres que les catapultes lanceraient. (5) Après cela ils formèrent trois nattes avec des câbles servant aux ancres des vaisseaux, de la longueur des murs de la tour et d’une largeur de quatre pieds, et les attachèrent aux extrémités saillantes des poutres, des trois côtés du mur qui faisaient face à l’ennemi: les soldats avaient éprouvé ailleurs que ce rempart était le seul qui fût impénétrable aux traits et aux machines. (6) Cette partie de la tour étant achevée, couverte, et fortifiée contre toute attaque de l’ennemi, ils transportèrent les mantelets aux autres ouvrages; et, prenant un appui sur le premier entablement, ils commencèrent à soulever le toit de la tour, et l’élevèrent (7) jusqu’à la hauteur que les nattes des câbles pouvaient mettre à couvert. Cachés sous cet abri et protégés contre toute insulte, ils travaillaient à la muraille de briques, élevaient de nouveau le toit et se donnaient ainsi de la place pour bâtir. (8) Quand ils étaient parvenus à un autre étage, ils faisaient encore un plancher avec des poutres dont l’extrémité était toujours cachée dans le mur, et de là ils élevaient de nouveau le toit supérieur et les nattes. (9) C’est ainsi que, sans s’exposer à aucune blessure, à aucun danger, ils construisirent six étages. On avait eu soin d’y ménager des ouvertures dans les endroits convenables pour le service des machines.
Construction d’une galerie couverte (2,10)
– 2,10- (1) Dès qu’ils furent assurés que de cette tour, ils pouvaient défendre les ouvrages qui en seraient voisins, ils commencèrent à construire, avec des poutres de deux pieds d’épaisseur, une galerie de soixante pieds de long, laquelle devait les mener de leur tour à celle de l’ennemi et au mur de la ville. Voici comment cet ouvrage fut exécuté. (2) On coucha d’abord sur le sol deux poutres d’égale longueur à quatre pieds de distance l’une de l’autre; on fit entrer dans ces poutres des piliers de cinq pieds de haut; on les lia ensemble au moyen de traverses un peu inclinées, afin qu’elles pussent porter les solives destinées à soutenir le toit de la galerie; par-dessus on mit des poutres de deux pieds d’épaisseur, attachées avec des bandes et des chevilles de fer; (4) enfin, au sommet du toit et sur ces dernières poutres, on cloua des lattes carrées, larges de quatre doigts, pour porter les briques que l’on mit dessus. (5) La galerie ainsi construite, et le toit formé de manière que les solives portaient sur les piliers, on recouvrit le tout de briques et de mortier, afin de n’avoir pas à craindre le feu qui serait lancé de la muraille; (6) sur ces briques on étendit des cuirs pour empêcher l’eau, qui pouvait être dirigée par des conduits, de détremper le mortier; et pour garantir ces cuirs eux-mêmes du feu et des pierres, on les revêtit de peaux de laine. (7) Tout cet ouvrage se fit au pied de la tour à l’abri des mantelets; et soudain, lorsque les assiégés s’y attendaient le moins, à l’aide de pièces de bois dont on se sert pour lancer un navire à l’eau, la galerie fut poussée contre la tour des ennemis, jusqu’au pied de la ville.
Impuissance des Marseillais (2,11-13)
-2,11 – (1) Effrayés de cette manœuvre imprévue, les habitants font avancer, à force de leviers, les plus gros quartiers de roche et les roulent du haut de la muraille sur notre galerie. La solidité de la construction résiste à ces coups, et tout ce que l’on jette dessus tombe du toit par terre. (2) Voyant cela, ils changent de dessein; ils allument des tonneaux remplis de poix et de goudron et les précipitent du haut de la muraille sur la galerie. Ces tonneaux roulent, et quand ils sont tombés par les côtés, on les écarte de notre ouvrage avec des perches et des fourches. (3) Cependant nos soldats, à couvert sous la galerie, travaillent à arracher, avec des leviers, les pierres qui soutiennent les fondements de la tour des ennemis. La galerie est défendue par les traits et les machines qui sont lancés de notre tour de briques; les assiégés sont écartés de leur muraille et de leur tour; on ne leur laisse pas la liberté de les défendre. (4) Enfin, un grand nombre des pierres qui supportaient la tour ayant été enlevées, une partie de cette tour s’écroule tout à coup. Le reste allait également tomber en ruines quand les ennemis, craignant le pillage de leur ville, sortent tous sans armes, la tête couverte de voiles, et tendent leurs mains suppliantes aux généraux et aux soldats.
-2,12 – (1) À ce spectacle si nouveau, tout service de guerre est suspendu, et nos soldats cessent les hostilités, curieux d’aller voir et entendre ce dont il est question. (2) Dès que les ennemis furent arrivés vers les généraux et les troupes, ils se jetèrent à leurs pieds et les conjurèrent d’attendre l’arrivée de César. (3) Ils voyaient bien que leur ville ne pouvait pas manquer d’être prise puisque les travaux étaient achevés et leur tour renversée. Ils renonçaient donc à se défendre. Si, à l’arrivée de César, ils n’exécutaient pas ses ordres, un seul mot de lui suffirait pour les anéantir. (4) Mais si la tour s’écroulait entièrement, ajoutèrent-ils, rien ne pourrait contenir les soldats; animés par l’espoir du butin ils envahiraient leur ville et la détruiraient de fond en comble. Les Marseillais, en hommes habiles, dirent ces choses et beaucoup d’autres du même genre en montrant une grande douleur et en versant des larmes.
-2,13 – (1) Touchés de leurs prières, les généraux font cesser les travaux et l’attaque, contents de laisser une garde aux ouvrages. (2) La compassion ayant établi une sorte de trêve, on attend l’arrivée de César. Ni d’une part ni de l’autre on ne lance plus de traits, et, comme si tout était fini, le zèle et l’activité se relâchent. (3) En effet, César avait, dans ses lettres, fortement recommandé à Trébonius d’empêcher que la ville ne fût prise d’assaut, de crainte que les troupes indignées de la défection et de la jactance des habitants, et des fatigues d’un long siège, n’en vinssent, comme elles en avaient menacé, à égorger toute la jeunesse. (4) On eut beaucoup de peine à les contenir; elles voulaient entrer dans la ville par force, et elles furent vivement irritées contre Trébonius, qui seul, pensaient-elles, les empêchait de s’emparer de Marseille.
Les Marseillais incendient traîtreusement les ouvrages (2,14)
-2,14 – (1) Mais nos ennemis perfides, méditant une trahison, ne cherchaient que le temps et l’occasion de l’accomplir. Après un intervalle de quelques jours, les esprits étant calmes et sans défiance, tout à coup, sur le midi, tandis que les uns s’étaient éloignés, que les autres, fatigués du travail, dormaient dans les ouvrages, et que toutes les armes étaient posées et couvertes, ils font une sortie, et, à la faveur d’un vent violent, mettent le feu à nos travaux. (2) Le vent pousse la flamme à tel point, qu’en un instant la terrasse, les mantelets, la tortue, la tour, les machines sont embrasés: tout fut consumé avant qu’on en pût savoir la cause. (3) Les nôtres, frappés d’un malheur si subit, prennent les armes qui leur tombent sous la main; plusieurs sortent du camp; ils courent sur l’ennemi; mais les traits lancés du haut des murs, les empêchent de poursuivre les fuyards. (4) Ceux-ci se retirent donc sous les murailles, et de là ils brûlent à loisir et la galerie et la tour de brique. Ainsi, par la trahison des assiégés et par la violence du vent, nous vîmes périr en un instant le travail de plusieurs mois. (5) Le lendemain, les Marseillais firent une nouvelle tentative; favorisés par le même vent, ils sortirent en foule, attaquèrent avec plus de confiance encore une autre tour et la terrasse, et y portèrent la flamme. (6) Mais, au lieu que les jours précédents nos soldats s’étaient relâchés de leur vigilance habituelle, ce jour-là, avertis par l’événement de la veille, ils avaient tout préparé pour la défense. Aussi, après avoir tué beaucoup de monde à l’ennemi ils le chassèrent dans la ville sans qu’il eût rien fait.
Réfection des ouvrages détruits (3,15)
-2,15 – (1) Trébonius, ayant résolu de rétablir ce qui avait été détruit, trouva ses soldats disposés à le seconder avec ardeur: car ils étaient indignés de voir tant de peines perdues, tant de travaux inutiles, et que l’ennemi, après avoir lâchement violé la trêve, insultât à leur valeur. Comme il ne restait plus de matériaux peur réparer ce dommage, les arbres ayant été coupés et enlevés dans tous les environs de Marseille, ils entreprirent une terrasse d’une espèce nouvelle et dont on n’avait jamais entendu parler. Ils élevèrent deux murs de briques de six pieds d’épaisseur, et à peu près éloignés l’un de l’autre par la largeur de la première terrasse, avec un plancher portant sur les deux murs. (2) Pour donner de la solidité à ce plancher, on mit entre les murs ou dans les parties trop faibles des solives transversales; et le tout fut recouvert de claies enduites de mortier. (3) Sous ce toit, le soldat, protégé à droite et à gauche et couvert de front par les mantelets, portait sans risque tout ce qui était nécessaire à l’ouvrage. (4) On travailla avec célérité; le zèle et le courage des soldats eut bientôt réparé le dégât. On ménagea des portes aux endroits qui parurent les plus propres à des sorties.
Situation désespérée des Marseillais (2,16)
– 2,16] – (1) Quand les ennemis virent ainsi rétabli en peu de jours ce qui, dans leur espoir, devait nous occuper longtemps; qu’il n’y avait plus moyen de nous tromper ni de nous attaquer à force ouverte; que nos soldats n’avaient pas plus à craindre leurs traits que nos ouvrages l’incendie; (2) qu’il nous était facile de fermer toutes les avenues de leur ville, du côté de la terre, par un même système de murs et de tours; que déjà nos remparts, élevés presque au pied de leurs murailles, et d’où nous pouvions lancer des traits avec la main, ne leur permettaient plus de se montrer, (3) et que cette proximité rendait inutiles les machines sur les quelles ils comptaient le plus; quand ils eurent enfin considéré, qu’obligés d’en venir aux mains du haut de leur murs et de leurs tours, il leur était impossible de lutter de valeur avec nous, ils pensèrent à se soumettre aux conditions qu’ils avaient déjà proposées.
Capitulation des Marseillais; César part pour Rome (2,22)
– 2,22 – (1) Les Marseillais, las enfin de tous les maux qu’ils souffraient, réduits à la dernière disette, deux fois vaincus sur mer, toujours repoussés dans leurs sorties, affligés de maladies contagieuses causées par la longueur du siège et par le changement de nourriture (car ils ne se nourrissaient plus que de millet vieilli et d’orge gâté, dont ils avaient jadis pourvu les greniers publics en cas de siège); voyant leur tour détruite, une grande partie des murs renversée, et n’espérant plus de secours ni des provinces ni des armées qu’ils savaient s’être soumises à César, ils se déterminèrent à se rendre de bonne foi. (2) Quelques jours auparavant, Domitius, ayant appris leurs intentions, avait préparé trois vaisseaux, en avait donné deux à sa suite, et, prenant pour lui le troisième, était parti par une tempête. (3) Les vaisseaux à qui Brutus avait donné l’ordre de veiller sur le port l’ayant aperçu, levèrent l’ancre et se mirent à sa poursuite. (4) Le vaisseau de Domitius fit force de rames, continua de fuir, et, à la faveur du gros temps, disparut; mais les deux autres, effrayés de se voir poursuivis, rentrèrent dans le port. (5) Les Marseillais, conformément à nos ordres, nous apportent leurs armes et leurs machines, tirent du port et de l’arsenal tous leurs vaisseaux, et nous livrent tout ce qu’ils ont d’argent dans te trésor public. (6) Après cela, César, conservant cette ville plutôt par considération pour son antiquité et sa renommée que pour sa conduite envers lui, y laisse deux légions en garnison, et envoie les autres en Italie; quant à lui, il part pour Rome.